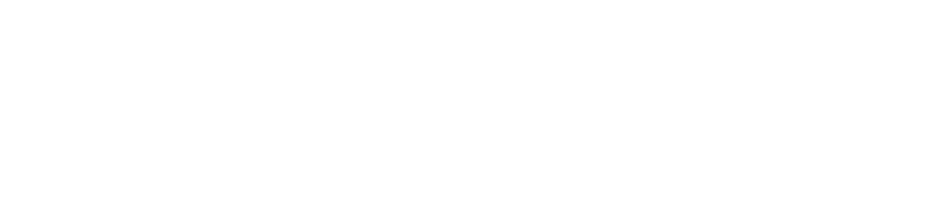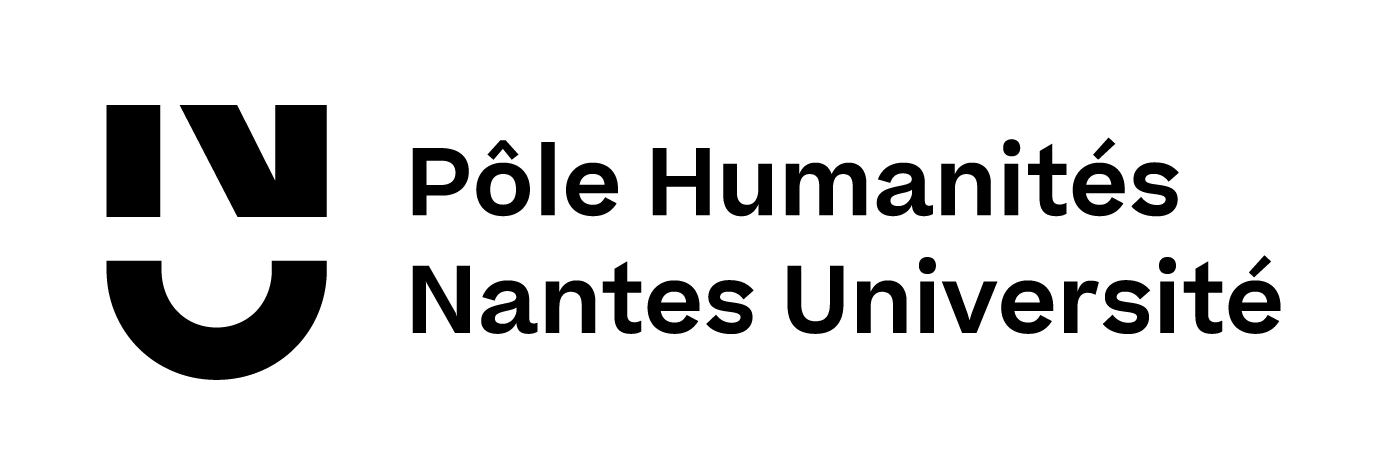- Recherche
SEMINAIRE "Faire de l'histoire"
-
Le 07 mars 2025 de 14:00 à 16:00false false
-
Amphi A - Campus Tertre
Troisième journée - Partie 1 - Interventions des doctorants (Partie 2 - Intervenant Lucien BELY - Vendredi 27 mars 2025)
- 14h-15h : Pierrick GERVAL, doctorant au CRHIA : “Les transgressions en temps de guerre dans le monde byzantin, VIIe - XIIIe siècle"
- Discutant : Nicolas DROCOURT, Maître de conférences en histoire médiévale à Nantes Université - CRHIA
- 15h-16h : Emilien SCHIRM, doctorant au CRHIA : " Les relations entre la France et le Hanovre (1680-1763)"
- Discutant : Stanislas JEANNESSON, Professeur en histoire contemporaine à Nantes Université - CRHIA
Emilien SCHIRM, doctorant au CRHIA
Directeur de thèse : Eric SCHNAKENBOURG
Résumé de la thèse :
Le propos de la thèse est d’étudier la politique de la France vis-à-vis du Hanovre dont les princes connaissent une ascension importante au sein de la société des princes au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles en devenant prince-électeur puis roi de Grande-Bretagne en 1714. Les multiples territoires rassemblés par les princes puis rois-électeurs conduisent à questionner l’existence d’une « diplomatie composite » issue de la collaboration des différents ministres des rois-électeurs. En réponse, la diplomatie française joue sur les différents statuts des princes/rois-électeurs de Hanovre au gré de ses intérêts. C’est, enfin, le travail des diplomates français, envoyés de second rang, qui est analysé en abordant leur quotidien, leur rapport au savoir, à l’écrit et leur capacité à s’insérer dans différents réseaux afin d’accomplir leur mission ou d’assurer leur carrière.
Pierrick GERVAL, doctorant au CRHIA
Directeurs de thèse : Annick PETERS-CUSTOT et Béatrice CASEAU
Résumé de la thèse
« La notion de transgression est issue de l’anthropologie et elle peut être adaptée au contexte de l’histoire byzantine. La guerre est considérée à Byzance comme une activité peccamineuse : l’idéologie impériale fait de l’empereur un artisan de la paix (eirènopoios) et le christianisme condamne les guerres entre chrétiens. Pourtant, tout au long de la période, l’Empire eut à faire face à de multiples menaces et certaines ont remis son existence en question, depuis les conquêtes perses, puis islamiques, du VIIe siècle jusqu’à la prise de Constantinople par les Vénitiens et les croisés en 1204. L’Empire connut également des phases de conquêtes, comme dans la seconde moitié du Xe siècle à l’époque des empereurs macédoniens. C’est par l’étude d’une documentation variée, comprenant des sources normatives (corpus juridiques et traités militaires), des sources narratives (chroniques et histoires), ainsi que des sources produites par les clercs (pénitentiels et textes hagiographiques), qu’il est possible de concevoir le rapport de la société byzantine à la violence et de déterminer les pratiques hors normes en temps de guerre. Ces recherches permettent de montrer que le regard sur ce qui relève de la transgression diffère selon le type de normes interrogées. Par exemple, l'indiscipline est une transgression, en droit, des normes de comportement attendues des soldats. Le massacre indistinct d'individus sans défense est moralement réprouvé, car assimilé à la cruauté. Enfin, la profanation et la souillure des corps, des objets liturgiques et des espaces sacrés apparaissent comme hautement intolérables du point de vue des élites ecclésiastiques byzantines. »
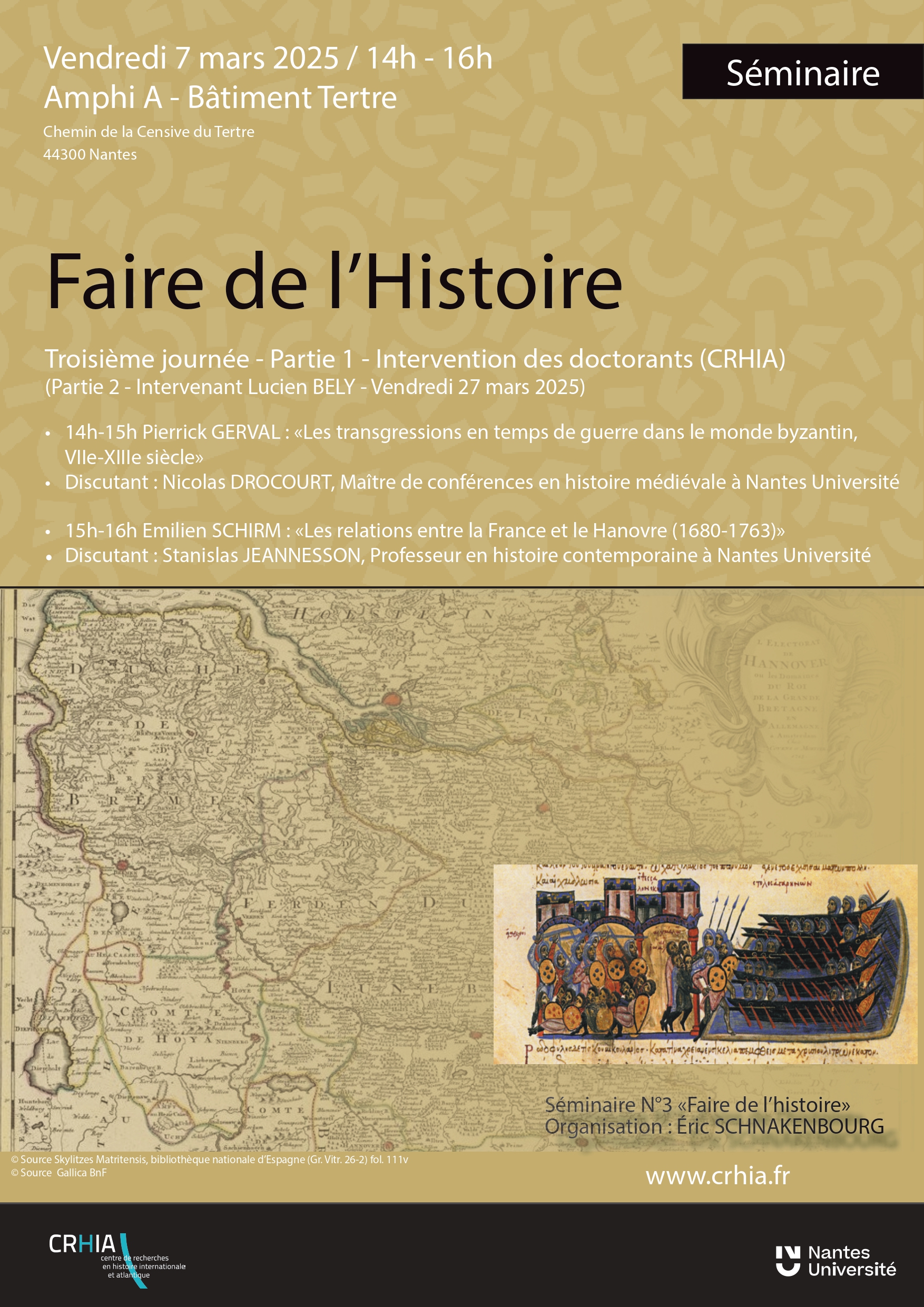
Mis à jour le 03 février 2025.